Noël Nouët, « Naissance d’un poème de circonstance », paru dans La Muse française, 10 juillet 1929
Cet extrait de presse est cité dans un article plus dense
Noël Nouët, poète (#39)
Tiré de La Muse française, 10 juillet 1929, Gallica
NAISSANCE D’UN POÈME DE CIRCONSTANCE
A Madame René Montlahuc,
qui malheureusement ne se
trouvait pas là pour le réciter.
Dégager les sentiments et les idées qui ont provoqué la naissance et accompagné la réalisation d’un poème de circonstance, voilà tout l’objet de ces notes. Un fameux romancier contemporain a tenu le journal de ses pensées à mesure qu’il composait un roman. Pour un poète cette lucidité est peut-être moins aisée. Il m’a une fois semblé amusant de fixer tout ce qui se passait en moi pendant que je préparais et que j’écrivais quelques vers. Par une sorte de dédoublement, j’ai observé le plus froidement possible un état d’assez vive ardeur. Il ne s’agissait pourtant que d’un poème de circonstance, mais il en est qui ne sont pas sans passion. C’est d’eux que parlait Gœthe lorsqu’il disait à Eckermann : « Toutes les poésies doivent être des poésies de circonstance. » (Ce qui signifie, il me semble, nées d’une émotion provoquée par les circonstances.)
Il est bien fâcheux que de telles notes exigent partout des « je » et que l’anecdote initiale soit nécessaire à l’intelligence du commentaire. Que le lecteur veuille bien excuser et les conditions et la donnée de cette tentative.
I
La scène est à l’étranger, fort loin de France, dans une capitale. Un journal, rédigé par un Américain, annonce succinctement et, semble-t-il, avec un peu d’humeur, que deux aviateurs français viennent d’arriver de Paris après un voyage merveilleusement réussi. Par malheur je réside à une distance assez grande de la ville, je dois me résigner à l’idée de ne pas voir ces compatriotes, ces « héros de l’air ». Je lèverai les yeux vers les nues le jour où ils repartiront : peut-être passeront-ils par ici ! Mais 1° un obstacle au voyage disparaît soudain ; 2° je reçois un télégramme d’amis qui m’invitent à me rendre à une réception en l’honneur des aviateurs. J’accepte donc avec grande joie. Voyage, pendant lequel je cherche à me représenter les héros. A l’arrivée, fête tapageuse : drapeaux, banderolles [sic], discours, fleurs, musique, preneurs de films. Après quoi je puis approcher les pilotes : ils ne sont pas tels que je les croyais. Ils sont simples, souriants. Les efforts considérables qu’ils ont dû faire, leur énergie, leur habileté,
les dangers courus, les choses vues, le prestige d’une réussite encore inédite, tout leur fait une auréole qui les accompagne comme malgré eux. Le lendemain matin, annonce d’une réception entre compatriotes, à l’ambassade de France, vers 4 heures. J’y suis convié. Ma matinée est libre, je sors dans la campagne et, tandis que je marche, l’idée d’un poème en l’honneur des aviateurs germe.
II
Quand on a un thème, quoi de meilleur que la marche solitaire, pour le traiter? Au début thème involontaire qu’on traite inconsciemment. Une espèce de gros bourgeon qu’on entrouvre, d’où l’on tire à demi des folioles chiffonnées, et auquel on ajoute aussi des choses du dehors. Je me répète quelques mots qui se rangent spontanément à une mesure. Des alexandrins épars, exprimant l’essentiel du sujet, se présentent, s’affinent, cherchent à se rapprocher. A ce moment éveil du « moi-quotidien », réaction. Que suis-je en train de ruminer? Un poème sur les aviateurs? Entreprise absurde. Et toute une série d’objections défile, dont la plus forte est celle-ci : « Tu sais bien que pour toi un poème est un rude travail. Tu n’as point de facilité et tu n’es jamais content de ce que tu fais. De ce que des vers se présentent, il ne faut pas conclure que le poème va se faire tout seul ! » Et la paresse me tire en arrière. Eh bien, tant pis ! Je m’obstine ou plutôt le sujet se cramponne. Ces types sont chics. Il faut le dire. Ils ont accompli une prouesse et ils restent simples, sympathiques. Cette antithèse est l’étincelle qui, à chaque choc, remet le feu. Les vers déjà faits brillent et attirent des éléments autour d’eux.
Tout en marchant je suis revenu vers la ville, mais je ne goûte pas ses détails pittoresques de la façon ordinaire. Je ne les sollicite pas, j’attends qu’ils viennent à moi et, chose précieuse, ils m’aident dans mon travail. Comme des serviteurs exotiques, patients, zélés, ils apportent à l’imagination juste ce qui lui est nécessaire. Les circonstances se disposent le mieux du monde en faveur de cette entreprise infime qui devient (je suis tenté de le croire) le centre de l’univers. Et voilà que tandis que je me mets à considérer ma nébuleuse ou plutôt mon essaim bourdonnant, une incarnation nouvelle de mon « moi quotidien », une espèce de « moi utilitaire » qui a constaté que les : « A quoi bon? » sont dépassés, que les « Pourquoi pas? » sont franchis, vient me murmurer perfidement (croit-il) : « Pour qui? » Évidemment composer
à grand ahan un poème pour, à la fin, en faire présent à un cartonnier moisi, à un tiroir poussiéreux, c’est une perspective peu stimulante. Le « directeur général des travaux» s’empare immédiatement de l’objection et décide que le poème est destiné aux héros et doit donc leur être adressé : « Vous qui avez fait ceci, etc. »
« Le lyrisme, dit Paul Valéry, est le développement d’une exclamation. » Je sens vivement combien c’est vrai. Le poème est un chant, c’est-à-dire un cri stylisé, harmonisé, orné, composé, mais un cri vers quelqu’un. Heureusement mon ébauche se trouve prête à adopter cette forme. Voilà une
étape nouvelle vers la réalisation. Cependant le « moi utilitaire » poursuit ses coups de pointe : « Pratiquement que feras-tu de ton poème? Vas-tu le mettre sous enveloppe et l’envoyer grossir le courrier des aviateurs? Le « moindre grain de mil », le plus simple compte rendu sportif ferait bien mieux leur affaire ! Ton entreprise reste entièrement déraisonnable. »
Mes yeux rencontrent une horloge : déjà si tard ! Comme les heures se volatilisent lorsque l’esprit travaille ! Il faut m’acheminer vers la maison de mes amis. D’ailleurs je ne puis plus rien ajouter à mon poème : j’y distingue des éléments pour plusieurs strophes, mais il m’est impossible de le pousser plus loin ici. J’ai besoin d’écrire. Seule, l’écriture, pour moi, situe, élimine, développe, fixe. Au dos de la carte d’invitation que je retrouve dans une poche, je note les points acquis. Quelques mouvements essentiels, des images, des mots. Je suis très avide maintenant de me trouver seul devant une table et une feuille de papier. Je presse le pas. Oui, j’ai mon « morceau » : je vois mon début, la progression, la conclusion. Pourtant rien n’est fait. Du dessin de l’architecte à l’achèvement d’un édifice, quelle distance ! Il se peut fort bien que l’entreprise en reste à ce point, que les matériaux assemblés s’émiettent, que j’oublie tout et qu’en mettant, après trois semaines, la main sur ces griffonnages, je n’y comprenne plus goutte. Il suffirait d’une rencontre, d’un hasard qui viendrait à l’aide du « moi bourgeois » affolé par mon projet et prêt à tout pour l’étouffer. Mais non ! Il vivra, ce poème, j’en ai une sorte de certitude instinctive ! Allons vite l’écrire !
III
Il vivra ! Et il n’ira pas se cacher sous une enveloppe ! Je sais maintenant ce que je vais faire. A la réunion de l’ambassade, cet après-midi, au moment favorable, je le tirerai de ma poche, je le lirai aux aviateurs et je le leur remettrai. Cela fera une surprise, un « numéro » inédit au programme. L’Ambassadeur est un lettré, il sait bien que je m’intéresse à la poésie, il aura de l’indulgence pour ce caprice.
A peine cette déclaration lancée par le chef, un charivari éclate. Tous les « moi » inférieurs protestent avec véhémence. Tumulte d’objections : « Folie pure ! Excentricité de vaniteux ! Et qui dit qu’on te laissera faire? D’ailleurs le poème n’est pas écrit : tu vends la peau de l’ours ! Ah ! On va bien rire dans la « colonie française ! » Qu’est-ce qu’on pensera de ce Monsieur d’un autre siècle venant déclamer des fariboles au nez de pilotes d’avion ? »
Il faut l’avouer, ces cris m’irritent, me tourmentent. Je déteste me singulariser. Et je sens, d’une façon plus aiguë que jamais, tout ce que la poésie, la poésie publique surtout, a de déplacé dans la vie d’aujourd’hui. Peut-on imaginer forme d’activité plus étrangère au train courant, plus anormale, plus hétérogène, plus vaine ! Un poète, même à supposer que ce ne soit plus un bohème, un personnage falot, mal mis, récitant des tirades à la lune, au papillon ou à la rose, un poète, du moment qu’il se manifeste, est un être « à part », inassimilable, frivole, presque toujours ridicule à quelque degré et, le plus souvent, ennuyeux. Mon « moi bourgeois » connaît admirablement sa thèse, celle des bourgeois en général, et il la présente avec tant de naturel que je ne vois pas que c’est lui qui parle. Il sent que je suis ébranlé, il redouble : « Tu n’as rien à gagner à cette aventure, tu ne peux qu’y perdre. On ne t’a rien demandé, n’est-ce pas? Reste donc tranquille. Rentrons. Ne pense plus à tout ça. Nous allons avoir un bon déjeuner. Après quoi nous lirons le journal. »
Je suis las. J’impose silence à toutes les voix. J’aspire l’air à pleins poumons. Je marche le plus vite possible. Et puis insidieusement un vers reparaît à la surface. Je suis sûr que dans l’atelier secret on n’a pas cessé de travailler. Le poème est là, tout proche, prêt à mûrir, prêt à se détacher de moi, à vivre indépendamment. Il ne m’appartient presque plus. Tout se passe comme si. comme s’il y avait une destinée pour les poèmes, un ordre établi à l’avance. Et je me demande si je n’ai pas un devoir à remplir. Un devoir, ah ! que ce mot est gros ! Mais enfin le poète a une fonction. De ces gens qui se réuniront tout à l’heure autour de leur ambassadeur et de deux compatriotes descendus du ciel, je suis peut-être le seul qui ait cette possibilité et par conséquent cette charge. De quoi s’agit-il? Au milieu de notre groupe, si positif qu’on veuille bien le supposer, une Beauté va passer, une Émotion va planer. Eh ! bien, c’est à moi qu’il appartient de dire le mot qui les signalera, c’est à moi de faire le geste pour montrer le sillon lumineux, c’est à moi d’exprimer ce que plusieurs, beaucoup peut-être, éprouveront fugitivement.
A cet instant le « moi ironique » se dresse en sifflant, au secours du « moi bourgeois » consterné : « Oh ! la la ! la mission sacrée du porte-lyre ! Parlez-moi des bobards romantiques ! » mais je ne l’écoute pas. Je ne l’écoute pas parce que je viens de me remémorer quelque chose de bien réel : le bonheur que j’ai éprouvé certains jours où j’avais écrit un poème, ce sentiment profond d’apaisement, d’épanouissement. J’avais pu négliger des engagements, méconnaître des intérêts pressants, j’étais épuisé, affamé. Qu’est-ce que cela faisait? J’avais la joie parce que j’avais accompli l’essentiel, j’avais rempli
mon rôle !
Bon ! ma décision est prise. Si l’ambassadeur le veut bien, je lirai mes vers aux aviateurs devant la « colonie» rassemblée. Nul ne saura pourquoi j’aurai entrepris cela. Je me moque sereinement de tout ce qu’on pourra dire, supposer, conclure à propos de ce geste. Je ris à l’avance des rieurs, s’il doit y en avoir. J’ai épuisé dès maintenant toutes les critiques. Une seule chose importe, c’est que mes vers ne soient pas mauvais. Je suis prêt à y donner tous mes efforts D’ailleurs me voici au seuil de mes amis, il n’y a plus qu’à les aviser de mon projet en deux mots et qu’à m’y mettre.
IV
Mes amis sont charmants, mais je tombe au milieu d’une discussion fort étroite. Je suis requis comme arbitre : « Tel détail de service est-il admissible? Mme X. pratique-t-elle de la sorte? N’est-il pas urgent de restaurer tel usage? » Je réponds au hasard, Je suis incapable de m’intéresser à ces questions, mais je sens une fois de plus mon courage m’abandonner. Comment exposer ce que j’ai à dire? Inopportunité accablante. Manque d’à propos absolu. Je souffre d’un refoulement de poésie. Étouffement cruel. Coincé entre le monde intérieur et le monde extérieur, je vois s’écouler en propos insipides des moments qui seraient si précieux pour moi, assis devant une feuille de papier ! Une exaspération muette se développe en moi. Je suis sur le point de crier : Zut ! et d’aller m’enfermer dans ma chambre. On me croira fou. Mieux vaut prétexter un malaise. Je me lève. A cet instant un second convive survient, puis l’on annonce le déjeuner. Je passe à table avec tout le monde. Comment, après le repas, pourrai-je écrire? Pour la poésie, rien de meilleur, à mon sens, que le jeûne. Quelle légèreté, quelle belle tension des nerfs dans un corps qui a faim ! Tant pis, je relègue mon personnage lyrique au second plan. Je ne veux plus, d’une heure, penser à mon poème.
Le repas achevé, pour ne pas m’enliser dans des conversations molles, je déclare aussitôt à mon hôte, mon intention de composer un « à-propos » en l’honneur de ceux que nous allons saluer deux heures plus tard. « Excellente idée ! » Mon hôte sait ce que c’est : il a jadis « taquiné la Muse », il a « troussé des couplets assez galants », il s’empresse à faciliter mon travail. Je suis séquestré dans un petit bureau. Me voici devant mon papier. Enfin ! « Poésie est délivrance ».
V
Les différents points arrêtés le matin répondent à l’appel. Les matériaux sont à pied d’œuvre. Je note pêle-mêle les mouvements, les développements, les images, les possibilités. Cela fait un petit morceau macaronique. J’ai envie de rire,mais je suis trop fiévreux, trop hâté. Par chance je ne me sens pas alourdi. Bien mieux, le phonographe qu’on a mis en marche dans le voisinage vient à mon aide. Souvent j’ai senti
comme la musique enfle l’imagination, trace des perspectives, transpose les émois, ouvre le ciel. J’entrevois des aspects nouveaux. Je rejette des éléments qui me semblaient définitifs et puis je me débats contre mes propres jalons. C’est la lutte obscure pour les rimes. C’est la mise en action du « métier ». Mécanique mesquine et précieuse pourtant. Tous les « moi » inférieurs sont terrés. Seul le « moi pratique » (est-ce raillerie? est-ce commisération?) murmure : « Tu n’auras jamais le temps ! » Mon Dieu ! C’est vrai !
Il faut renoncer à une ode. Une forme restreinte s’impose. Allons ! ce sera un sonnet. Aussi bien il faut ménager les auditeurs. Je remanie, remanie. En vérité le sonnet est un cadre excellent pour l’esprit. S’il est vrai que le poème doit marcher vers un but, aboutir à un épanouissement, cette progression est déjà matériellement dessinée dans le sonnet, et sa chute mais pourquoi ce nom? sa prétendue chute
est une cime, un fronton, un pinacle. Tout en écrivant, je pense aux vers-libristes : parfois je les envie mais plus souvent je les plains. Ils vont au hasard. Leurs poèmes sont des vapeurs que le vent emporte de côté et d’autre, puis déchire.
Mon sonnet est sur pieds. Comme les heures ont passé vite ! Je me souviens de cette humiliation qu’éprouvait Vigny à constater le gaspillage de temps qu’exige un assemblage de quelques vers. Bah ! une fois l’œuvre faite, on ne regrette rien. Je respire largement. Le poème est là. Je le lis comme pour le déclamer. Hélas! Pas fameux! J’avais rêvé autre chose. Et j’entreprends la chasse d’une tournure trop rude, d’un trait peu clair. A travers la porte on me lance une question plaisante, à laquelle je réponds gaîment. Je reprends mon sonnet, je le recopie, je le transforme, je lime des arêtes. Il faut que tout se suive, coule, s’enchaîne, avance, mais il faut aussi que cela ait du rythme, qu’on y voie danser des figures, que des rêves y prennent naissance. On m’appelle, il est temps de partir. Je fais une nouvelle copie à la hâte. C’est fini, il n’y faut plus songer. Suis-je content? Suis-je déçu? Je suis soulagé.
VI
L’exploitation matérielle n’a, en somme, aucune importance. Comment ai-je lu mon sonnet? Je m’en souviens à peine. Mon ami a assumé le rôle de manager. Oui, je lui en dois de la reconnaissance : j’étais las, indifférent, je n’aurais plus eu le goût de proposer cette fantaisie. Mais au moment qu’on m’a indiqué, j’ai tiré mon sonnet de ma poche. L’assistance faisait cercle, j’étais en face des aviateurs, j’ai lu le plus clairement que j’ai pu, lentement, lentement. (On m’a enseigné cela jadis comme un principe essentiel !) Les aviateurs ont reçu mon papier, m’ont serré la main. L’ambassadeur a eu l’amabilité de faire de même. Une vieille dame est venue me féliciter, tandis que les autres couraient au buffet. Je me suis mis à discuter une question de statistique avec un agent d’une compagnie de navigation. J’étais étonné moi-même de l’ardeur que j’y mettais. Je me sentais affranchi du démon ou de l’ange qui m’avait mené si rudement depuis le matin. J’étais ravi d’être redevenu un homme comme les autres. Et pourtant, au fond…
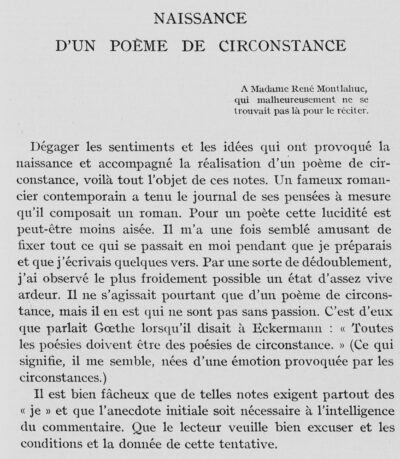
Noël NOUET